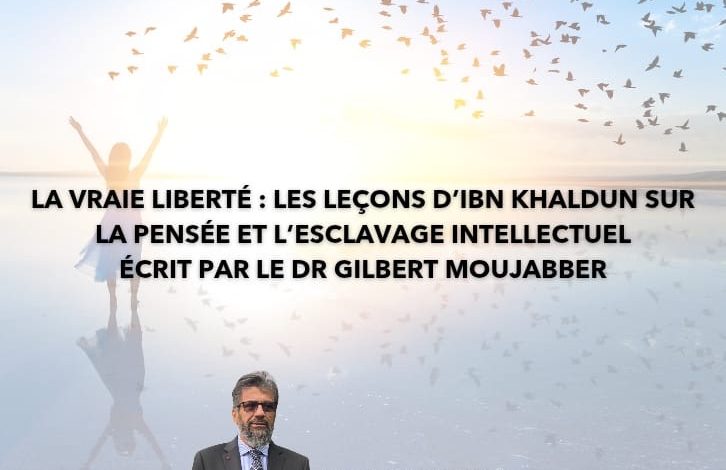
La vraie liberté : les leçons d’Ibn Khaldun sur la pensée et l’esclavage intellectuel
Écrit par le Dr Gilbert Moujabber
À notre époque moderne, où l’information s’accélère et les opinions se multiplient, la question de la liberté intellectuelle est devenue plus urgente que jamais. La liberté de pensée signifie-t-elle le droit d’un individu à exprimer n’importe quelle idée ? Ou bien faut-il être capable de distinguer le bien du mal, indépendamment de l’influence des autres ? Dans ce contexte, Ibn Khaldun, le grand penseur arabe, propose une réflexion profonde sur le concept de liberté intellectuelle. À travers sa célèbre maxime : « L’homme libre défend une idée, peu importe qui la prononce, et l’esclave défend une personne, peu importe l’idée qu’elle défend. » Nous pouvons voir à quel point ses idées sur la liberté de pensée restent pertinentes dans notre réalité contemporaine.
Corps principal :
Ibn Khaldun, considéré comme l’un des fondateurs de la sociologie et de la pensée libre, distingue trois types de personnes dans leurs relations avec les idées et nous offre des éclairages profonds sur le sens de la liberté :
• Les gens libres : Selon Ibn Khaldun, les gens libres sont ceux qui défendent une idée en se basant sur sa validité et sa logique, quelle que soit la personne qui l’a avancée. Les gens libres ne sont pas influencés par l’identité ou l’autorité de la personne qui propose l’idée. Ils évaluent plutôt l’idée en fonction de son contenu et de son impact sur la réalité. Ces personnes jouissent d’une liberté de pensée indépendante et n’ont pas peur d’affronter la vérité, aussi dure soit-elle. Dans notre monde contemporain, les gens libres sont ceux qui critiquent impartialement les idées dominantes et adoptent des positions critiques envers l’autorité et les idéologies établies.
• Les esclaves : En revanche, Ibn Khaldun décrit les « esclaves » comme ceux qui défendent des personnes ou des autorités, quelle que soit la validité de leurs idées. Ces individus ne s’intéressent pas tant au contenu de l’idée qu’à la personne qui la propose. Ils tombent dans le piège de la dépendance aveugle et sont incapables de penser de manière indépendante. Aujourd’hui, nous observons que ces personnes représentent souvent la majorité dans de nombreux domaines, de la politique aux médias, où la loyauté envers les individus ou les pouvoirs dominants prime sur l’intérêt pour le fond de l’idée ou du problème.
• Le pire : La troisième catégorie, qu’Ibn Khaldun considère comme la plus dangereuse, est celle qui attaque les idées simplement parce que la personne qui les propose n’est pas en accord avec leurs orientations personnelles ou politiques. Ces individus rejettent une idée en fonction de la personne qui la porte, et non en fonction de la valeur intellectuelle ou logique de l’idée elle-même. Cette catégorie démontre comment la subjectivité et les préjugés dominent la pensée rationnelle, ce qui conduit à l’exclusion des faits et à la marginalisation des idées objectives.
Conclusion :
La déclaration d’Ibn Khaldun n’est pas seulement une réflexion historique, mais un appel profond à comprendre correctement la liberté intellectuelle. Dans notre monde contemporain, où les divisions idéologiques se creusent et où l’on défend de plus en plus les individus indépendamment de la validité de leurs idées, il est essentiel de revenir aux réflexions profondes d’Ibn Khaldun. La véritable liberté intellectuelle ne se limite pas au droit d’exprimer ses idées, mais implique la capacité de juger les idées de manière objective, libre de toute émotion ou loyauté personnelle. À une époque où les voix se multiplient et où les conflits intellectuels sont de plus en plus intenses, l’appel d’Ibn Khaldun reste plus que jamais nécessaire : être libres dans nos pensées, sans être contraints par le fanatisme ou la dépendance, et juger les idées en fonction de leur force et de leur véracité, et non de celui qui les présente.




